Mission : Impossible – The Final Reckoning est, en théorie, la seconde partie de Dead Reckoning – Part One. Ce premier volet bénéficiait d’un excellent scénario, transposant de manière originale la figure de HAL (2001 : L’Odyssée de l’espace) dans l’univers de l’espionnage et de la manipulation planétaire. Le film était solidement construit, avec un remarquable équilibre entre scènes explicatives et séquences d’action, toutes parfaitement intégrées les unes aux autres. Dans The Final Reckoning, Christopher McQuarrie et Erik Jendresen semblent avoir perdu toute ambition, livrant une conclusion pour le moins décevante, à peine sauvée par deux séquences d’action marquantes. À l’élan d’un spectacle débordant d’idées et d’énergie succède une narration laborieuse, aux enjeux affadis et à la progression dévitalisée.
Cette suite installe peu à peu un étrange sentiment : celui d’un film évoluant dans un univers parallèle, factice, comme s’il développait une réalité alternative. Or, dans l’univers de l’espionnage — qui repose généralement sur une extrapolation plausible du réel, une anticipation d’un temps possible — cette rupture d’adhérence avec le monde contemporain fait rapidement naufrage. Ce décalage finit même par prendre la forme d’une étonnante apologie de l’« État profond », en contradiction frontale avec l’esprit du premier film de la saga, signé Brian De Palma, qui au contraire jouait sur la défiance envers les institutions.

Tout commence avec l’entrée en scène de la Présidente des États-Unis, incarnée par l’actrice noire Angela Bassett — peu convaincante ici. Le problème est immédiat : la réalité politique actuelle rend ce postulat difficile à avaler. Inutile de rappeler que Kamala Harris a été largement battue par Donald Trump — un fait que nul spectateur ne peut ignorer. On se dit alors que les scénaristes auraient gagné à revoir leur copie, et la production inspirée en effectuant des retakes qui auraient permis de mieux coller au monde tel qu’il est. Mais loin de se corriger, le film double la mise : le rôle de la Présidente gagne en importance au fil du récit. Plus le film avance, plus il semble dépassé par la réalité qu’il prétend anticiper.
Dans l’attente d’une apocalypse nucléaire orchestrée par L’Entité, la fameuse intelligence artificielle, The Final Reckoning s’enferme littéralement dans le QG du commandement militaire, tandis qu’Ethan Hunt tente, une fois de plus, de sauver le monde. Le scénario, paradoxalement, choisit d’évacuer presque tous les personnages intéressants du précédent opus. Grace (Hayley Atwell) est réduite à un rôle fonctionnel, tandis que Paris (Pom Klementieff) disparaît presque complètement du récit. Son destin, prétendument émouvant, sonne creux tant son développement dramatique frôle l’insignifiance.

Autre limite du film : une volonté d’inclusion qui tourne souvent à la caricature. Des personnages sont introduits pour cocher des cases, sans réelle caractérisation. Ils ne sont que des silhouettes symboliques, jamais incarnées. Le résultat affaiblit la dynamique dramatique : puisque leur position morale est d’emblée sans ambiguïté, il devient trop facile d’identifier les traîtres — qui sont systématiquement des hommes blancs. À ce petit jeu, le spectateur attentif a toujours un coup d’avance, ce qui nuit à la tension scénaristique. Ce manque de finesse s’étend jusqu’aux scènes d’action. Lors d’un combat à mains nues entre Ethan et un sous-marinier, le surgissement d’une officier au physique bodybuildé pour sauver la situation est si prévisible qu’il désamorce toute surprise. Le sommet est atteint avec un personnage féminin d’origine inuite, dont le rôle semble plaqué sur le récit à la mince justification narrative, et dont l’interprétation frôle l’amateurisme. Là encore, le film semble sacrifier la cohérence interne à des impératifs de représentation mal intégrés, affaiblissant d’autant plus son propos et sa portée.
Les militaires, les responsables politiques, les agents des services secrets et les communicants sont réunis, confinés autour de la Présidente des États-Unis, dans l’attente du déclenchement d’un conflit nucléaire. Cette situation évoque bien évidemment Docteur Folamour (Dr Strangelove, 1964) de Stanley Kubrick et surtout Point limite (Fail Safe, 1964) de Sidney Lumet. Mais là où Kubrick maniait un cynisme ravageur et où Lumet imposait une froideur implacable, McQuarrie reste à la surface des choses. Il ne possède ni la virulence critique du premier, ni la rigueur dramatique du second. Le suspense, pourtant central, peine à s’installer. L’un des moments censés provoquer un choc — la décision de la Présidente de sacrifier une ville américaine en signe de « bonne volonté » — est directement emprunté à Point limite, dans lequel le Président, incarné par Henry Fonda, prend une décision similaire pour éviter une guerre totale avec l’Union soviétique. La référence est ici totalement assumée, jusqu’à l’écho final : la Présidente est sauvée grâce au sacrifice du Général Sidney (Nick Offerman) — un nom qui ne doit évidemment rien au hasard.

Christopher McQuarrie convoque ici des plans et motifs tirés des précédents volets de la saga, avec une volonté évidente de rendre hommage au premier Mission: Impossible, réalisé en 1996 par Brian De Palma. Sur le papier, l’idée est plutôt prometteuse : redonner un rôle à William Donloe (Rolf Saxon), l’analyste de cybersécurité chargé de la salle informatique de la CIA dans la célèbre séquence du premier film — celle où Ethan Hunt, suspendu à un filin, infiltre la forteresse numérique de l’Agence. Devenue emblématique de la saga, cette scène reste l’un des sommets de mise en scène de De Palma. Mais là où De Palma faisait preuve d’une maîtrise glacée, McQuarrie étire maladroitement le personnage de Donloe, désormais exilé sur une île en mer de Béring. Il l’intègre à l’équipe d’Ethan Hunt, avec son épouse inuite déjà évoquée — un ajout qui, au lieu d’enrichir l’intrigue, déséquilibre l’ensemble. Leur présence occupe un espace narratif disproportionné, au détriment d’autres personnages mieux ancrés dans l’univers de la série.
Le problème va plus loin : le scénario finit par réintégrer l’équipe d’Ethan Hunt dans le giron officiel de la CIA, gommant ainsi les tensions fondatrices de la saga. Pire encore, le film tente une forme de réhabilitation du personnage de Jim Phelps tel qu’il apparaissait dans le film de De Palma, par l’intermédiaire de son fils, Briggs (Shea Whigham). Ce retournement est d’autant plus troublant que Peter Graves, l’interprète emblématique de Phelps dans la série télévisée, avait refusé de reprendre son rôle en 1996, choqué par la manière dont De Palma l’avait transformé en traître. Il estimait que cela trahissait l’héritage de la série originelle, annulant symboliquement toutes les missions accomplies par son personnage.
Or, cette trahison était justement le cœur du projet de De Palma, qui portait un regard très critique sur la CIA. Le film de 1996, avec son atmosphère de paranoïa et de dissimulation, résonnait avec les nombreuses opérations d’ingérence bien documentées de l’agence américaine à travers le monde. La tension venait de là : d’un monde instable, où les héros eux-mêmes étaient susceptibles de basculer. The Final Reckoning, en blanchissant l’institution et ses figures ambivalentes, tourne le dos à cet héritage subversif. Il ne reste qu’une mécanique lisse, aseptisée, là où le doute et la suspicion faisaient autrefois toute la force de la franchise.

Mais dès que Christopher McQuarrie s’affranchit du poids des dialogues sur-explicatifs et des figures imposées par le cahier des charges hollywoodien, Mission: Impossible – The Final Reckoning se métamorphose. Le film retrouve alors une ampleur spectaculaire digne de son héritage. À partir du moment où Ethan Hunt redevient seul maître de son destin, il retrouve aussi son aura de héros insaisissable, celui que les spectateurs attendent depuis le premier plan. Deux séquences s’imposent alors comme de purs moments de cinéma : l’impressionnante descente dans les abysses à bord du sous-marin Sébastopol, et la haletante poursuite en biplan de Gabriel (Esai Morales), qui renoue avec la tradition du cinéma d’aventure pur, sans cynisme ni surcharge numérique.
Présenté comme le dernier volet de la franchise avec Tom Cruise, The Final Reckoning prend une direction diamétralement opposée à celle du dernier James Bond, Mourir peut attendre (No Time to Die, 2021). Christopher McQuarrie et Tom Cruise ont l’élégance de ne pas tuer leur héros. Pas de sacrifice final ici, pas d’icône brisée : Ethan Hunt disparaît silencieusement dans la foule des anonymes. La classe.
Fernand Garcia
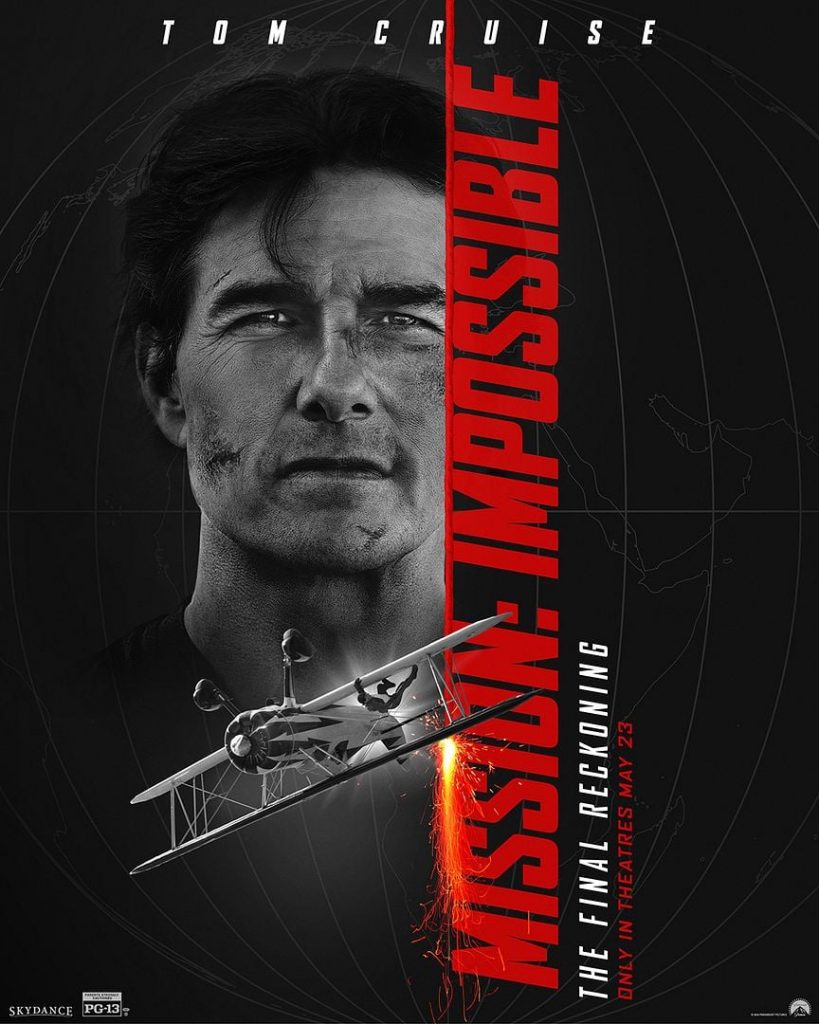
Mission : Impossible – The Final Reckoning (Mission :Impossible – The Final Reckoning), un film de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Angela Bassett, Cary Elwes, Katy O’Brian … Scénario : Christopher McQuarrie & Erik Jendresen d’après la sérieTV créée par Bruce Geller. Image : Fraser Taggert. Décors : Gary Freeman. Costumes : Jill Taylor. Montage : Eddie Hamilton. Musique : Max Aruj et Alfie Godfrey. Thème Mission: Impossible : Lalo Schifrin. Producteurs : Tom Cruise et Christopher McQuarrie. Production : TC Productions – Skydance Media – Paramount Pictures. Distribution (France) : Paramount Pictures France (Sortie le 21 mai 2025). Etats-Unis. 2025. 2h49. Couleur. Eastmancolor. 35 mm Panavision. Arri mini Alexa. Format image : 2,39:1 et IMAX (1,90:1). Dolby Atmos. Dolby Digital. Dolby Surround 7,1. IMAX 6-Track. DTS:X. Dolby Cinéma. DCP 4K. Tous Publics. Sélection Officielle, Hors Compétition, Festival de Cannes, 2025. Copyright photos Paramount Pictures.
