1943. En Afrique du Nord, le lieutenant Walker (Robert Mitchum) ordonne à l’un de ses hommes de se débarrasser d’un petit chiot embarqué dans le camion de troupe. À contrecœur, les soldats abandonnent l’animal, surnommé « l’Arabe ». Au pied du véhicule, le correspondant de guerre Ernie Pyle (Burgess Meredith), témoin de la scène, recueille le chiot. Touché par les pleurs de l’animal, Walker décide finalement de faire monter Pyle et le chiot à bord. Tandis que la compagnie quitte le désert tunisien pour entamer sa remontée vers Rome en passant par la Sicile, Pyle se lie peu à peu aux jeunes soldats qu’il accompagne.
« En dehors des Forçats de la gloire de Wellman, qui a vraiment compris ce que sont la boucherie et la mort, tous les films de guerre sont plutôt naïfs et complètement faux », écrivait Samuel Fuller. Et d’ajouter : c’est « le seul film adulte et authentique produit par Hollywood durant la Seconde Guerre mondiale ». Au-delà du compliment, Fuller savait de quoi il parlait. Fantassin puis reporter de guerre au sein de la Big Red One — à laquelle il consacrera plus tard un film semi-autobiographique —, il avait emprunté en partie le même itinéraire que la compagnie de soldats suivie par William Wellman.

Les Forçats de la gloire — un titre français aux accents de contresens — ne met en scène aucun soldat en quête de gloire. Tous ne cherchent qu’à survivre. Wellman filme la guerre à hauteur d’homme, sans emphase, sans pathos, en s’appuyant sur les articles d’Ernie Pyle. Âgé de 44 ans, ce journaliste a suivi la progression de la Compagnie C du 18e Régiment d’infanterie américaine, depuis les sables de Tunisie jusqu’à la bataille de Monte Cassino. Son témoignage, simple, objectif, dénué de manichéisme, fait office de socle pour le film. Pyle est un personnage du récit, mais il ne prend jamais le pas sur les autres. Il ne surplombe pas la troupe, il la suit. C’était sa volonté : se fondre dans le groupe, raconter la guerre de l’intérieur, sans artifice. Il n’est que l’intermédiaire entre le spectateur et la réalité du front. Les Forçats de la gloire ne présente pas de héros. Seulement des soldats ordinaires, confrontés à la chaleur, la pluie, la boue, l’attente, la peur, et parfois la mort. Wellman capte ces existences sans hiérarchie, dans une succession de scènes où prime la vérité des gestes et des instants. C’est la guerre vue par ceux qui la font, et non par ceux qui la commentent.
William Wellman ne souhaitait pas réaliser Les Forçats de la gloire, malgré l’insistance du producteur Lester Cowan. Il n’était d’ailleurs pas le premier choix : John Huston, initialement pressenti, dut décliner, indisponible au moment du tournage. Wellman connaissait la guerre. Il avait été ambulancier dans la Légion étrangère, puis pilote de chasse au sein de la célèbre escadrille Lafayette pendant la Première Guerre mondiale — une expérience à laquelle il consacrera son dernier film, Lafayette Escadrille, en 1958. Mais ayant combattu dans les airs, il ne se sentait pas légitime pour raconter la guerre des fantassins. Ce n’est que la justesse des articles d’Ernie Pyle, leur ton honnête et désencombré de toute rhétorique, qui finirent par le convaincre. Sa rencontre avec le journaliste acheva de dissiper ses réticences. Wellman accepta de tourner le film, non pas comme un récit de guerre spectaculaire, mais comme un témoignage à hauteur d’homme, fidèle à l’esprit du reportage de terrain.

La mise en scène de William Wellman épouse, par petites touches, la démarche d’Ernie Pyle. Il s’attarde sur les gestes mécaniques, les pauses silencieuses, les regards perdus. Le front y apparaît comme un espace d’attente, d’épuisement, de déplacements incessants — rarement comme un champ de bataille ou d’exploits héroïques. De cette accumulation de détails, d’attitudes furtives, de silences partagés, naît une forme de caractérisation discrète mais profonde. Les soldats ne sont pas réduits à des silhouettes anonymes : ce sont des individualités inscrites dans un collectif, dont les traits se dessinent peu à peu, à travers un mot, un regard, une réaction. L’émotion du film naît précisément de cette attention aux petites choses, de cette façon qu’a Wellman de filmer l’ordinaire pour mieux dire l’essentiel. Un petit chiot, mascotte de la compagnie, passe de soldat en soldat, comme un fragile symbole d’humanité. Un disque vinyle, contenant les premiers mots du bébé d’un soldat, devient l’objet d’une quête obsessionnelle : trouver un phonographe pour l’écouter. Certaines séquences surprennent, comme ce mariage improvisé dans les ruines d’une église, suivi d’une « nuit de noces » dans une ambulance déglinguée sans roues — le marié s’endort, tandis qu’à l’extérieur, tout le bataillon s’imagine, dans le silence, ce moment de tendresse ou de désir. Il y a aussi les escapades d’un soldat italo-américain en quête d’un peu d’amour auprès d’une villageoise.
Mais la guerre rattrape tout, avec sa brutalité, ses coups imprévisibles, sa mécanique absurde. Au pied du monastère de Monte Cassino, perché sur une colline, l’horreur culmine. Le lieu, point d’observation stratégique occupé par les nazis, devient un enfer pour les troupes alliées. Impossible de l’atteindre sans subir de lourdes pertes. L’état-major refuse d’abord d’y envoyer l’aviation, pour ne pas détruire un monument historique. Assaut après assaut, les soldats reviennent brisés, psychologiquement lessivés. Et quand l’ordre de bombarder le monastère est enfin donné, l’absurdité atteint son sommet : en ruines, l’édifice devient un retranchement encore plus efficace pour l’armée allemande.
Le style de William Wellman, sans effets appuyés, touche parfois au documentaire. Il obtient de l’armée que 140 soldats en activité participent au tournage. Beaucoup d’entre eux tomberont plus tard dans le Pacifique. Ernie Pyle lui-même mourra sur la petite île de Shima (ou Le-jima), au nord-ouest d’Okinawa. Il avait pourtant donné son feu vert au scénario des Forçats de la gloire, validé le choix de Burgess Meredith pour l’incarner — mais ne verra jamais le film terminé. Correspondant de guerre jusqu’au bout, Pyle est mort comme un simple soldat. Comme s’il était, à son tour, entré dans ses propres récits.

Cette proximité entre Pyle et les fantassins ne se manifeste pas seulement sur le terrain : elle trouve une résonance bouleversante dans une séquence magistrale du film. Dans une grotte creusée à même le sol, servant de poste de commandement précaire, Pyle retrouve le capitaine Walker — promu depuis leurs premières rencontres. Le visage fermé, la voix lasse, Walker est rongé par le désespoir. Tous deux sont des hommes de l’écrit, mais leurs tâches les opposent. Pyle raconte la vie des soldats. Walker, lui, passe ses nuits à rédiger les lettres individuelles qui annoncent la mort d’un soldat à ses proches — aux parents, à l’épouse, à la fiancée. La vie et la mort réunies dans ce sombre sous-sol avec cette très belle idée que les mots pèsent autant que les balles.
Robert Mitchum, dans son premier rôle important, est absolument remarquable. Il incarne le capitaine Walker avec une justesse et une force d’évocation impressionnantes, un homme fatigué qui tente de faire tenir debout ses hommes. Ce rôle lui vaudra d’ailleurs sa seule nomination à l’Oscar — dans la catégorie du meilleur second rôle. Mitchum avait débuté modestement au début des années 1940, après avoir pas mal bourlingué. Les Forçats de la gloire marque une révélation : il devient rapidement un acteur de premier plan. Avec un naturel stupéfiant et une grande sobriété, Mitchum impose un type de personnage devenu sa signature : l’homme solitaire, rebelle, énigmatique, ambigu. Son jeu se caractérise par une décontraction apparente, une forme de nonchalance qui masque, selon les rôles, une sensibilité à vif ou une noirceur menaçante. En 1955, son interprétation d’un pasteur psychopathe dans La Nuit du chasseur (The Night of the Hunter), unique réalisation de Charles Laughton, entre dans la légende : un rôle sidérant dans l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma. Sa carrière est jalonnée de chefs-d’œuvre, du film noir au western, avec en contrepoint une image d’homme libre, parfois sulfureux. « L’alcool, les filles – tout est vrai. Inventez d’autres trucs si ça vous chante », aimait-il dire, résumant avec ironie et détachement son propre mythe. En 2018, Bruce Weber lui consacrera un superbe documentaire, Nice Girls Don’t Stay for Breakfast, construit autour d’un long entretien. Robert Mitchum est, à tous égards, un géant.

William Wellman et son chef opérateur Russell Metty optent pour une photographie réaliste, organique, presque tactile. Le vent, la pluie, le soleil, la terre, la boue, la pierre — tout devient matière de cinéma, autant d’obstacles physiques auxquels les soldats sont confrontés. Le cadre est pensé pour être au plus près des hommes, captant tour à tour les individualités ou les silhouettes anonymes, se détachant dans l’éclair des bombes qui lacèrent la nuit. Cette beauté brutale, presque expressionniste par moments, anticipe l’esthétique de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, quarante ans plus tard.
Dans cet univers oppressant, où la bande-son est saturée de bruits de guerre, de cris, de souffles et de silences chargés de mort, Wellman insère pourtant des touches d’humour inattendues. Par la musique, d’abord : dans une séquence où les soldats progressent dans une ville en ruines, chaque communauté croisée est associée à un rythme musical différent, comme une façon d’humaniser brièvement le chaos. Par le dialogue aussi : ainsi cette scène savoureuse entre Dandaro, le soldat italo-américain, et Ernie Pyle, où une conversation à propos d’une actrice hollywoodienne prend une tournure manifestement intime, voire grivoise — chaque réplique « gênante » étant recouverte opportunément par le fracas d’une explosion. C’est un clin d’œil malicieux à la censure, un pied de nez au code Hays, avec lequel Wellman a souvent eu maille à partir. Fidèle à son tempérament, il trouve ici une manière d’exprimer librement la trivialité joyeuse des soldats sans jamais la trahir ni l’édulcorer. Il utilise brillamment la voix off afin de remettre en situation des actes de guerre. Il intègre dans son montage final des plans tournés sur les lieux mêmes des combats (par John Huston) insufflant ainsi à son propre récit des événements un souffle de réalisme sidérant.
Avec Les Forçats de la gloire, William Wellman signe l’un de ses chefs-d’œuvre, mais aussi l’un des sommets du cinéma américain. Film essentiel, d’une rare justesse, il bouleverse les codes du film de guerre en refusant l’héroïsme, le patriotisme, pour mieux embrasser la vérité du terrain, la fatigue, l’absurde et l’humanité. Son influence sur le genre sera considérable, jusque chez Samuel Fuller, Robert Aldrich (assistant sur le film), Stanley Kubrick ou Terrence Malick. Un film important, nécessaire. Un incontournable.
Fernand Garcia
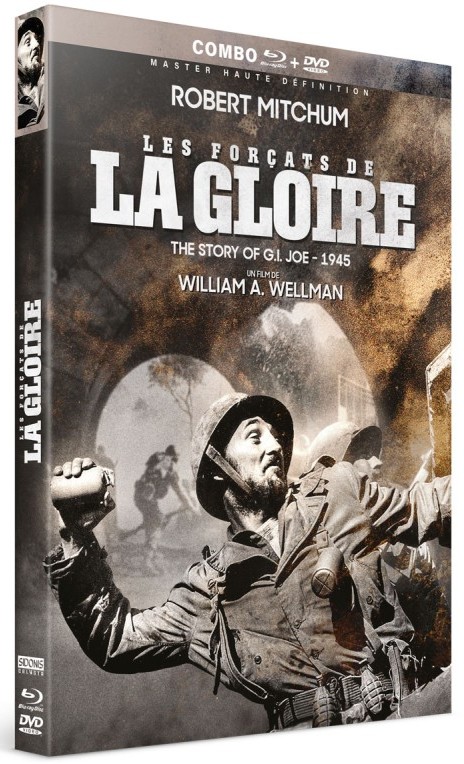
Les Forçats de la gloire est disponible en combo (Blu-ray + DVD) ou unitaire DVD chez Sidonis Calysta dans une superbe restauration 2K, effectuée à partir du négatif original. L’image et le son bénéficient d’un remarquable travail de remasterisation, qui rend pleinement justice à la mise en scène de William Wellman. En complément, on trouve une excellente présentation du film par Olivier Père . Il y qualifie Les Forçats de la gloire comme « certainement l’un des plus grands films de guerre jamais réalisés, un des meilleurs, un des plus importants, et plus généralement l’un des meilleurs films américains des années 40, et un des plus grands films du cinéma américain… un film extraordinaire. » Une analyse précise, riche en informations, qui revient sur les principaux artisans du film, sa genèse et son importance historique. Un supplément indispensable pour accompagner la redécouverte de cette œuvre magistrale (32 minutes). À cette édition, l’éditeur ajoute un documentaire prodigieux : La Bataille de San Pietro (San Pietro) de John Huston, produit en 1943 par l’armée américaine. Jugé trop violent et brutal par le War Department, le film fut d’abord interdit de projection aux troupes, malgré une réduction du montage de Huston, passé de 50 à 32 minutes. Le commentaire, sobre et grave, est assuré par Huston en personne. Malgré le « gommage » opéré par les services de l’armée, La Bataille de San Pietro demeure un document exceptionnel, d’un réalisme cru. Huston mêle images authentiques du front et plans reconstitués, sans jamais en atténuer la force. Il montre les corps, les pertes massives, la lenteur de la progression des fantassins dans un paysage lunaire, détruit par les combats. Ces visions de désolation suffirent à effrayer l’état-major : il n’y avait qu’un pas pour considérer ce film comme un brûlot anti-guerre. Un contrepoint parfait aux Forçats de la gloire, et un document à part entière, aussi fort que rare (1943, noir et blanc, 1.33:1, 32 minutes.).
Les Forçats de la gloire (G.I. Joe / Story of G.I. Joe) un film de William A. Wellman avec Burgess Meredith, Robert Mitchum, Freddie Steele, Wally Cassell, Jimmy Lloyd, Jack Reilly, Bill Murphy… Scénario : Leopold Atlas, Guy Endore et Philip Stevenson. Directeur de la photographie : Russell Metty. Décors : James Sullivan. Assistant-réalisateur : Robert Aldrich. Supervision du montage : Otho Lovering. Montage : Albrecht Joseph. Musique : Ann Ronell et Louis Applebaum. Producteur Associé : David Hall. Producteurs : Lester Cowan et William A. Wellman. Production : Lester Cowan Productions – United Artists. Etats-Unis. 1945. 1h48. Noir et blanc. Format image : 1,37:1. Tous Publics. Rétrospective William A. Wellman à la Cinémathèque française du 27 août au 15 octobre 2025.
